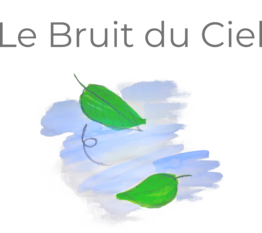| [À lire en écoutant De mon âme à ton âme de Kompromat feat. Adèle Haenel] Hello, Je le savais. Ça fait quelques jours que je le dis et que je le sens. Peut-être que le changement d’heure l’a précipité. Ou la baisse des températures, le syndrome prémenstruel, la pluie. Ou rien de tout ça ou tout à la fois. Cette espèce d’épuisement qui m’a tranquillement envahie. Qui a pris son temps. Ne négligeant aucune de mes cellules, aucune parcelle de mes sensations. Cette lassitude teintant progressivement chaque bout de moi. Tout devient un peu lourd. Mes pensées sont lourdes, mon corps aussi, mes paupières surtout. Tout est plus rugueux, plus difficile, moins fluide. Comme si le panel d’émotions auquel j’ai accès dorénavant se situe entre la tristesse, la solitude et la mélancolie. Plus de force pour la joie, la légèreté, l’enthousiasme. Ni même pour la colère. C’est juste un moment de transition, je sais. C’est simplement d’avoir été beaucoup et sans peine dans mille choses à la fois. D’avoir mené de front plein de projets, d’avoir partagé des idées, d’avoir réfléchi à plusieurs ou seule, d’avoir réglé des plus ou moins gros problèmes, d’avoir rencontré tant de gens et d’avoir eu envie de les rencontrer vraiment, d’avoir eu un truc de prévu chaque jour et chaque soir ces dernières semaines. De n’avoir été presque jamais seule pendant presque deux mois. Sans effort. C’était facile. C’était une phase comme ça, exceptionnelle. Ça ne m’était je crois, jamais arrivé. Ce noyage volontaire et conscient dans un tourbillon de personnes, de travaux, de partages. Sans que me manquent les longs moments seule avec moi-même, dans la forêt, un livre ou une contemplation. Toujours en lien avec moi, pour autant. Enfin je crois. Et sous-tendue d’une énergie intarissable. Sans effort, donc. Je les ai vus, les petits indices qui me disaient que ça ne durerait pas. Les petits signaux qui m’alertaient que c’était bientôt la fin du surf hyper aisé des grosses vagues sous le soleil sans hésitation et sans trébuchement. Qu’il me fallait songer à aménager mon quotidien pour me rattraper au vol. Que la chute serait un peu rude, qu’il pouvait être chouette de penser à l’adoucir. La montée de la fatigue a été graduelle. Le tiraillement s’est amplifié, lors de cette ascendance, entre l’envie de silence, et la peur de ce que cela représente. Entre le besoin de repos, et l’angoisse de quitter l’agitation. Entre l’appel de la solitude, et l’inquiétude de m’éloigner des autres. De ne plus être aimée. Comme si je ne savais plus faire, que j’avais perdu l’habitude. Comme si je n’y voyais même plus l’intérêt. Et que je pouvais vivre toute ma vie comme ça, pleinement tournée vers l’extérieur, de mon camion/maison, de mon corps, de moi. Que je pouvais m’investir de tout mon être dans mille projets avec mille personnes, et plus encore, et faire fi de ce qui en moi hurle(nt) à l’attention, à la douceur, à la lenteur, au repli, aux chuchotements – hurle(nt) en moi qu’il faut baisser d’un ton. Comme s’il suffisait de fermer les yeux sur ce qui en moi a(ont) besoin de mon regard, de ma tendresse, de mes soins. Et m’efforcer de poursuivre. C’est non. Je refuse. Je refuse de faire des efforts. De « tenir » ce rythme sans l’énergie. Ces rencontres sans l’enthousiasme. Ces projets sans la légèreté. Je refuse de surpasser la difficulté que représente le fait d’avancer en étant coupée de moi, en ne pouvant m’occuper de moi. Juste parce qu’il faut, que c’est bien, que c’est comme ça, la vie. Je refuse de m’asservir délibérément. De constater avec clarté que j’ai besoin de m’éloigner, et de rester quand même. Je refuse d’enfouir mes douleurs. Je refuse de nier mon rythme, mes cycles, mes vagues. Je refuse de laisser tomber la joie. Je refuse de faire à contrecœur, à corps défendant. Je refuse de lâcher sciemment la facilité, l’aisance, la fluidité, l’évidence. Je m’arrête volontairement au premier obstacle. Celui qui, si je le franchissais, me ferait perdre ce lien-là, avec moi, avec mes émotions, avec les parts de moi qui ne suivent pas. Celui qui me ferait perdre confiance en moi, en mes capacités à m’enlacer du dedans, à être patiente avec ce qui tremble en moi, à me regarder avec douceur, à m’assoir auprès de ce qui en moi est inquiet, à écouter et à m’attendrir. Je m’arrête avant que cela devienne dur. Je suis lâche, ou alors je m’offre le plus beau cadeau qui soit. Alors, ces derniers jours, j’ai ralenti. J’ai fermé des cycles. J’ai clos des travaux. J’ai moins répondu. J’ai laissé plus de temps, plus de suspens. J’ai abrégé. J’ai réduit. Peu à peu je me suis retournée vers moi. J’ai vu (un peu) moins de monde. J’ai davantage lu. Je me suis protégée du bruit et des foules. J’ai soufflé. J’ai respiré. Malgré tout, la chute est brutale. Je ne me suis peut-être pas assez éloignée, ou pas assez vite. J’avais peut-être encore trop peur de ne plus sentir que je suis aimée si je m’éclipsais franchement. En tout cas, après un envahissement progressif, presque délicat, par l’épuisement, entre la nuit de dimanche à lundi l’abattement m’a submergée. Bim. La pénibilité du mouvement, le vide dans le cœur, les pensées creuses, à fleur de peau et d’émotions. Vulnérable. On me demande comment je vais et je pleure. On me demande pourquoi et je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais plus lire, je ne sais plus écouter, je ne sais plus répondre ni être là. Je suis fatiguée. Je reste avec. Je regarde le vide dans les yeux. Et le vide sous mes yeux prend sa vraie forme de parts de moi en manque de moi. J’ouvre les bras, elles se blottissent. Je passe deux jours comme cela. Annulant quelques événements prévus, en maintenant d’autres. Deux jours avec moi mais pas seulement. Ça n’est toujours pas assez. Alors ce matin, je m’arrête vraiment. J’arrête tout. J’annule tout. Je me retire. Je mets des chansons douces et puissantes dans mon casque, je coupe mon téléphone et, assise face aux arbres verts et oranges au creux de la forêt, j’écris. Je m’accorde enfin toute l’attention dont j’ai besoin. Je me panse. Je me ressource. Je respire à pleins poumons. Je n’ai plus peur. Je n’ai plus mal. Je ne suis plus vide. Le sourire revient. Faiblement. Fragile. C’est juste un moment de transition, je sais. La transition vers un rythme d’hiver, un rythme d’obscurité, de gestes lents et de tendres attentions. Un rythme du dedans. Je dois me réaccorder. J’ai anticipé, créé, organisé, structuré, maintenant je dois me reposer. Me laisser porter. Oublier le cadre et les fondations – ça tient debout tout va bien – et plonger dans la vie qui se meut en leur centre. Doucement. Je dois me remplir pour pouvoir mieux donner. Je dois marcher seule pour pouvoir courir à leurs côtés. Je dois me déposer, me recroqueviller, pour pouvoir me déplier et enlacer. Je dois rentrer pour mieux ressortir. Je dois clore mes yeux pour mieux sourire. Je retourne dans ma grotte, et vous souhaite un bel automne, Alexe |